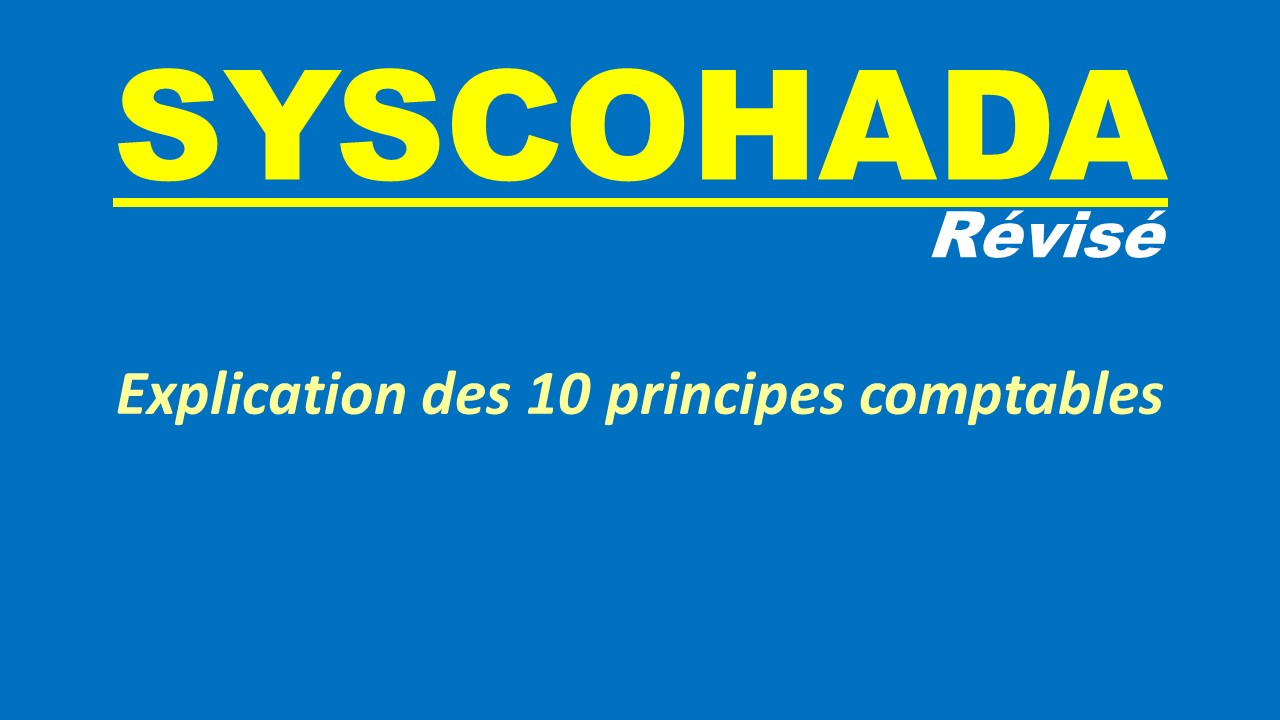SYSCOHADA : LES PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX
- 5 Postulats comptables
- 5 Conventions comptables
PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX
Les principes comptables fondamentaux structurent la présentation comptable de l’entité issus historiquement de la pratique comptable, ces principes sont intégrés dans les cadres conceptuels et les normes comptables, et tirent leur légitimité de leur reconnaissance par les acteurs du monde comptable. Ce sont les postulats et conventions comptables qui sont couramment regroupés sous le terme générique de principes comptable.
I. Postulats et conventions comptables
1. Les postulats comptables
Les postulats permettent de définir le champ du modèle comptable. Ce sont des principes acceptés sans démonstration mais cohérents avec les objectifs fixés.
Les postulats pour définir le champ du modèle comptable du système comptable OHADA sont les suivants :
· Postulat de l’entité
· Postulat de la comptabilité d’engagement
· Postulat de la spécialisation des exercices
· Postulat de la permanence des méthodes
· Postulat de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique
1.1. Postulat de l’entité
Il s’agit d’une hypothèse fondamentale portant sur la relation entre, d’une part, la personne morale ou le groupe et d’autre part son ou ses propriétaires (exploitant, associés, actionnaires, membres). En effet, l’entité est considérée comme étant une personne morale ou un groupe autonome et distinct de ses propriétaires et de ses partenaires économiques. La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre le patrimoine de l’entité et celui de ses propriétaires. Ce sont les transactions de l’entité et non celles des propriétaires qui sont prises en compte dans les états financiers de l’entité.
Une entité s’étend à toute organisation exerçant une activité économique et qui contrôle et utilise des ressources économiques. Lorsqu’une entité (personne morale) contrôle une ou plusieurs entités, l’ensemble forme un groupe qui doit présenter des états financiers consolidés.
1.2. Postulat de la comptabilité d’engagement ou d’exercice
Les effets des transactions et autres événements sont pris en compte dès que ces transactions ou évènements se produisent et non pas au moment des encaissement ou paiement. Ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent. L’information financière ainsi établie, à l’exception de celle contenue dans le tableau des flux de trésorerie et sous réserve des dispositions spécifiques concernant le Système Minimal de Trésorerie, renseigne les utilisateurs, non seulement sur les transactions passées ayant entraîné des flux de trésorerie, mais également sur des obligations et autres évènements entraînant des encaissements et des paiement futurs.
1.3. Postulat de la spécialisation des exercices
Ce postulat, prévue à l’article 59 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, signifie que la vie de l’entité étant découpée en périodes appelées « exercice » à l’issue desquels sont publiés des états financiers annuels, il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et les charges qui le concernent (nés de l’activité de cet exercice), et ceux-là seulement.
D’une manière générale, lorsque des revenus sont comptabilisés au cours d’un exercice, toutes les charges ayant concouru à la réalisation de ces revenus doivent être déterminées et rattachées à ce même exercice.
Ce raisonnement ne peut s’étendre à toutes les charges car certaines ne peuvent être rattachées à aucun produit déterminé et constituent des charges « de période » engendrant réduction d’actif ou augmentation de passif. L’exemple type est constitué par les frais d’administration générale de l’entité.
Le respect de ce postulat est assuré par le biais de comptes dits de régularisation qui permettent d’ajuster les produits et les charges dans le temps.
Enfin, une entité doit ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour tenir compte des événement postérieurs à la clôture de l’exercice mais antérieurs à la date d’arrêté des comptes si ceux-ci contribuent à confirmer des situations qui existaient à la clôture de l’exercice (par exemple : révélation de la situation compromise d’un client rendant la créance douteuse).
Par contre, les évènements postérieurs à la clôture de l’exercice mais antérieurs à la date d’arrêté des comptes qui indiquent des situations apparues postérieurement à la clôture de l’exercice ne donnant pas lieu à des ajustements des états financiers (par exemple : sinistre intervenu après la date de clôture ne remettant pas en cause la continuité d’exploitation
1.4. Postulat de la permanence des méthodes
Le postulat de permanence des méthodes rappelé dans l’article 40 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière exige que les mêmes méthodes prise en compte, de mesure et de présentation soient utilisées par l’entité d’une période à l’autre. En effet, la comptabilité et la cohérence des informations comptables au cours de périodes successives implique la permanence des méthodes d’évaluation et de présentation.
Le terme « méthode comptable » s’applique - aux méthodes et règles d’évaluation et de présentation des comptes.
On peut cependant déroger à la fixité des méthodes si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l’entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleur information financière compte tenu des évolutions intervenues.
1.5. Postulat de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique
Selon ce postulat, pour que l’information représente d’une manière pertinente les transactions et autres événements qu’elle vise à représenter, il est nécessaire qu’ils soient enregistrés et présentés en accord avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.
Le Système comptable OHADA opte pour une application limitée de ce postulat comptable.
II. Les conventions comptables
Les conventions comptables sont destinées à guider le préparateur des comptes dans l’évaluation et la présentation des éléments devant figurer dans les états financiers. Elles ont un caractère de généralité moins grand que les postulats comptables et peuvent varier d’un pays ou d’un espace géographique à un autre.
Les conventions comptables servant de guide pour l’élaboration des états financiers annuels du Système comptable OHADA sont les suivantes :
- Convention du coût historique
- Convention de prudence
- Convention de régularité et transparence
- Convention de la correspondance bilan de clôture- bilan d’ouverture
- Convention de l’importance significative
2.1. Convention du coût historique
La convention du coût historique consiste à comptabiliser les opérations sur la base de la valeur nominale de la monnaie sans tenir compte des éventuelles variations de son pouvoir d’achat. Il repose sur la stabilité de l’unité monétaire qui doit permettre d’additionner des unités monétaires de différentes périodes, sans dénaturer l’information comptable.
Selon la convention du coût historique, les actifs sont comptabilisés pour le montant payé ou pour la valeur de la contrepartie qui a été donnée pour les acquérir. Les passifs sont comptabilisés pour le montant des produits reçus en échange de l’obligation ou, dans certains circonstance (par exemple, les impôts sur les bénéfices), le montant que l’on s’attend à verser pour éteindre le passif (passif externe) dans le cours normal de l’activité.
Selon les articles 35 et 36 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, la méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du coût historique. Ainsi donc, à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ;
- Les actifs produits par l’entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur actuelle ;
- Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur actuelle des actifs reçus, sauf si cette valeur actuelle ne peut être estimée de façon fiable. Dans ce cas, les actifs acquis sont comptabilisés à la valeur actuelle des actifs donnés en échange.
Le choix du coût historique se justifie par le fait que la valeur d’origine constitue une information véritable reposant sur une évidence.
2.2. Convention de prudence
Cette convention est énoncée d’entrée dans les articles 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière : « la comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées. »
La prudence est l’appréciation raisonnable des faits dans des conditions d’incertitude afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitude présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l’entité.
2.3. Convention de régularité et transparence
Dans le droit comptable OHADA, cette convention a été affirmée dans l’article 6,8, 9, 10, et 11 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. En fait, il imprègne tous les textes relatifs à l’information externe.
Il faut inclure dans ce concept :
· La conformité aux règles et procédures du Système comptable OHADA au plan comptable et à sa terminologie, à ses présentations d’états financiers (notion de régularité) … ;
· La présentation et la communication claire et loyale de l’information, sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence (article 6 de l’Acte uniforme) ;
· Le respect de la règle de non-compensation, dont l’inobservation entraînerait des confusions juridiques et économiques et fausserait l’image que doivent donner les l’états annuels. Sont uniquement autorisées les compensations juridiquement fondées (article 34 de l’Acte uniforme) en vertu de la loi ou du contrat.
2.4. Convention de la correspondance bilan de clôture – bilan d’ouverture
Cette convention est appelée à l’article 34 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière : « le bilan d’ouverture d’un exercice, doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédents ».
2.5. Convention de l’importance significative
Cette convention, bien qu’énoncée formellement à l’article 33 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, à propos des notes aux états financiers, concerne également tous autres états financiers.
Sont significatifs « tous les éléments susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité » (article 33 de l’Acte uniforme).
Cette définition de l’importance significative par ses conséquences sur le jugement des utilisateurs montre le caractère relatif du critère (en fonction de la taille de l’entité notamment ) et la difficulté de son application , puisqu’elle place en responsabilité les comptables, les dirigeants et les auditeurs , qui ont à prendre la décision de retenir ou non l’élément en fonction de son importance significative présumée, donc de son influence sur le jugement porté par telle ou elle catégorie de lecteurs des états financiers annuels.
------------------------------------
Extrait de l’ACTE UNIFORME